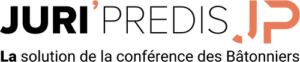16 minutes de lecture
C’est en 1982, dans le cadre d’un quatuor de textes plus connus sous le nom de « lois Auroux », que le législateur décidait de revisiter le droit du travail pour plus d’un tiers de son Code. Par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il donnait la possibilité au travailleur de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Tel que le soulevait le Sénat lors des travaux préparatoires, le salarié se voyait doté d’un pouvoir d’initiative jusqu’ici absent des textes et qui n’était alors accordé qu’aux membres des CHSCT, nouvellement instaurés pour remplacer les CHS et reprendre le rôle des CACT, à l’article L.231-9 du Code du travail applicable à l’époque [1].
Véritable fait justificatif de désobéissance salariale, si le droit de retrait se veut être protecteur à l’égard des salariés, le fait de pouvoir l’exercer dans le contexte pandémique que connaît le territoire à l’heure actuelle au travers du COVID-19 est loin de relever de l’évidence et alimente une controverse aussi brumeuse qu’intense.
Ce qu’est le droit de retrait : un concept juridique indéterminé
Droit désormais codifié à l’article L4131-1 du Code du travail, la disposition pose trois principes quant à la possibilité de se retirer :
- Une obligation pour le travailleur d’alerter, immédiatement, son employeur, d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (alinéa 1er) ;
- Si tel est le cas, la possibilité pour ce dernier d’exercer un droit individuel qu’est le retrait de la situation de danger (alinéa 2e) ;
- Une interdiction pour l’employeur de demander au travailleur de reprendre son activité si la situation persiste (alinéa 3e).
Pour autant, ce fait justificatif se heurte à l’indétermination des concepts qu’il pose. En l’absence de définition précise de la notion de « danger », de « gravité » ou d’« imminence », ainsi qu’eu égard au fait de devoir rapporter « un motif raisonnable de penser que », le salarié n’aura d’autre choix que de passer ces différents éléments de fait au prisme de son esprit, et de le livrer au filtre interprétatif de la raison du juge.
En effet, c’est au pouvoir souverain du magistrat qu’il revient de tracer, au cas par cas, les contours des termes, dans le but d’apprécier les éléments de la cause et de déterminer si le salarié peut valablement se prévaloir d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent (Pour des illustrations d’énonciation de ce pouvoir souverain, voir : Cass. soc., 11 déc. 1986, n° 84-42.209 ; Cass. soc., 20 janv. 1993, n° 91-42.028 ; Cass. soc., 23 mai 2001, n° 99-42.577 ; Cass. soc., 27 sept. 2017, n° 16-22.224).
Pour des résultats similaires, voir : https://bit.ly/3bqJHpd
Retrait d’une situation de danger et cas de force majeure : une différence de taille
Considérer qu’une situation dangereuse est un cas de force majeure reviendrait, dans la fiction, à appliquer le régime juridique de cette dernière, et ainsi ses critères, au fait justificatif de retrait. En d’autres termes, il faudrait rapporter que la situation est, cumulativement, extérieure, imprévisible, et irrésistible (ndlr : depuis la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la nouvelle rédaction de l’article 1218 du Code civil ne reprend plus le terme d’irrésistibilité stricto sensu, critère semblant lui-même avoir été abandonné par la Cour de cassation dans l’un de ses deux arrêts de principe rendus en Assemblée plénière le 14 avril 2016, n°02-11.168).
Première différence liminaire, sauf contre-exemple particulier isolé, la force majeure a de longue date été appréciée objectivement par les juges, c’est-à-dire « in abstracto », n’observant que la situation présentée et elle seule, en faisant abstraction des circonstances de la cause. Pour sa part, tel que l’a rappelée la Cour de Cassation, le droit de retrait ne requiert pas de situation objective de danger grave (Cass. soc., 23 avril 2003, n° 01-44.806). Il est apprécié subjectivement, c’est-à-dire « in concreto », en tenant compte de considérations personnelles telles que le fait d’être une personne « à risque ».
Dans un second temps, le rapport des trois critères de la force majeure est des plus délicat.
Imprévisibilité
D’abord, concernant l’imprévisibilité, la difficulté sera de poser un critère métrique relatif à sa détermination, une date précise à partir de laquelle une contamination était possiblement prévisible. L’on pourrait imaginer que de cette façon, la personne circulant en période de déplacement restreint rencontrera une difficulté quasi insurmontable à démontrer l’imprévisibilité de la transmission du COVID-19. Le cas sera plus retors quant à un individu l’ayant contracté bien avant.
Irrésistibilité
Pour ce qui est de l’irrésistibilité, la force majeure impose de démontrer l’impossibilité de surmonter le risque, possibilité ne pouvant s’analyser comme un simple empêchement ou une difficulté accrue à remplir ses obligations contractuelles. Une nouvelle fois, une controverse féroce émergerait, entre autres, sur le fait d’opposer une impossibilité de se mouvoir lorsqu’un ensemble de mesures destinées à prévenir la contamination tel que les recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé ont été respectées. À titre d’illustration, les personnes travaillant dans une entreprise ne relevant pas des établissements pouvant accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 conformément à l’arrêté publié le 16 mars 2020 au JORF[2] et dont l’entreprise ne peut pas organiser de télétravail, seraient obligées de démontrer que malgré les mesures sanitaires respectées par l’entreprise le risque de contamination ne peut être empêché.
En outre, il est à noter que les juges admettent très difficilement la force majeure, même dans les cas de situations épidémiques. De cette façon, la force majeure n’a pas été reconnue dans le cas d’un contrat conclu après l’épidémie de chikungunya (CA Saint-Denis, 29 décembre 2009, RG n° 08/02114), de même que les juges ont estimé que le risque sanitaire lié au SRAS (déjà causé par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu en Chine et en Asie du Sud-Est entraînant plusieurs centaines de décès) n’était pas majeur (v. P. Guiomard, Dalloz actualité, 4 mars 2020) ou encore dans le cadre du virus Ebola (CA Paris, 29 mars 2016, RG n° 15/05607) et de l’épidémie de Dengue considérée comme prévisible (CA Nacy 22 novembre 2010, RG n° 09/00003).
Extériorité
Dernier critère, celui de l’extériorité, ne saurait non plus être appliqué à une situation fondant le retrait puisque, le cas échéant, le travailleur n’aurait que la possibilité d’invoquer des éléments pris en dehors de sa propre considération, alors que les juges ont accueilli comme motif légitime de retrait des considérations personnelles à l’instar de l’état de santé d’un salarié. En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation posait en 1996 le principe selon lequel « il ne résulte pas des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail que la condition d’extériorité du danger soit exigée de manière exclusive » (Cass. soc., 20 mars 1996, n° 93-40.111). De cette façon, la cause du danger peut résider dans la personne même du travailleur.
Enfin, le Code du travail lui-même distingue sans équivoque, dans une section consacrée à la mise en place du télétravail, les deux motifs pour lesquelles une telle mesure peut être décidée afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés : « les circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie », ou « en cas de force majeure », les deux ne se confondant donc pas (article L1222-11 du Code du travail).
Comment exercer son droit de retrait ?
À titre préalable, le salarié doit informer son employeur de la situation de danger auquel il se trouve exposé et préférablement, s’il en a un, son comité social et économique (CSE) exerçant depuis le 1er janvier 2020 les missions des CHSCT. L’alerte est donc un prérequis essentiel.
L’employeur sera quant à lui tenu de prendre les mesures prévues, tant par le Code du travail que par les recommandations gouvernementales du moment, afin de s’assurer du respect de l’intégrité physique des travailleurs. Il devra s’assurer du respect dans son entreprise des mesures de distanciation et celles dites « barrières » dont la liste actualisée est disponible ici, avoir informé et préparé son personnel, fournir si nécessaire des solutions hydroalcooliques ou encore l’accès à un point d’eau et de savon permettant un lavage de mains. Selon le Gouvernement, les masques ne sont quant à eux pas recommandés en l’absence de symptômes, et les gants sont considérés comme inutiles puisque pouvant devenir support du coronavirus et le transmettre.
S’agissant d’un droit individuel, et bien qu’il puisse être exercé de façon collective, la demande doit être formulée à titre personnel. Le salarié n’a par ailleurs pas à obtenir l’autorisation d’exercer un droit qui lui est consacré par les textes et dont il se saisit. Étant un droit, l’employeur ne peut non plus contraindre son salarié à exercer son droit de retrait, ou lui en faire le reproche en cas de survenance d’un dommage et de trouver dans son non-exercice une cause exonératrice de responsabilité.
D’un point de vue strictement théorique et juridique, il n’est pas exigé que cette information soit matérialisée en étant donnée de façon écrite, ce quand bien même un règlement intérieur prévoirait le contraire. La Haute juridiction a en ce sens pu considérer qu’une telle exigence était de nature à restreindre l’usage du droit de retrait (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-15.744), un degré de rigueur absent dans la lettre du texte. Si la notification de l’employé à l’employeur se fait alors par tout moyen, le droit nous enseigne que la problématique ne tourne pas systématiquement autour de ce qui est légal ou non, mais plutôt de ce qui est opportun de ce qui ne l’est pas. Puisque les écrits restent et que les paroles s’envolent, le rapport d’une preuve en cas de contestation ne sera que facilité par l’écrit.
Enfin, dans l’éventualité où le salarié n’exprimerait pas son droit de retrait au sens strict, et que celui-ci refuse simplement de procéder sans sécurité et sans protection aux tâches qui lui sont assignées, les juges auront l’obligation de rechercher par eux même si le salarié ne justifiait pas d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présenter un danger grave ou imminent (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44.234).
Corolaires : les conséquences du droit de retrait
Le législateur a anticipé la contradiction d’intérêts entre employeur et salariés lorsque ces derniers exercent leur droit de retrait.
De cette façon, il est interdit pour l’employeur de demander au travailleur de reprendre le travail dans la même situation (art. L4131-1, al. 1er du Code du travail). De même, aucune sanction et aucune retenue de salaire ne pourront être exercées à l’encontre d’un travailleur retiré (art. L4131-3 du Code du travail). Dans le cas d’un éventuel licenciement décidé pour ce motif, celui-ci pourra être frappé de nullité (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-21.272) et être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 janv. 2009, n° 07-44.556).
Une attention particulière doit être portée au fait que l’exercice du droit de retrait n’est pas sans risques, son exercice illégitime pouvant être sanctionné.
Il est à rappeler que si un danger grave et imminent permet au salarié de se retirer de son poste, ce fait justificatif ne saurait pour autant viser le poste en lui-même. De cette façon, le retrait se veut être parfaitement limité à la situation de danger elle-même, c’est-à-dire à la non-exécution de la tâche qualifiée de « dangereuse » en raison de son contexte de réalisation, le salarié devant exécuter cette tâche d’une autre façon s’il le peut. Le droit de retrait ne s’apparente donc pas à une possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, le travailleur devant demeurer disponible à l’employeur.
Ensuite, dans un tel cas, une retenue de la rémunération du salarié peut être effectuée, peu importe que ce dernier soit resté à la disposition de l’employeur, laquelle retenue s’analyse en une contrepartie de l’absence de fourniture de travail. Pis, l’employeur n’est en aucun cas tenu de saisir préalablement le juge pour le faire (Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 07-87.650).
De même, face à un cas d’exercice illégitime, les différentes sanctions disciplinaires prévues en droit du travail peuvent être prononcées à l’encontre du salarié sans contrôle préalable du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Un licenciement peut donc être juridiquement fondé, non pas pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse. Ainsi en est-il, par exemple, d’une salariée se prévalant d’un motif raisonnable de penser que les courants d’air qu’elle ressentait dans son bureau présentaient un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, ce comportement constituant selon la Cour de cassation « des actes caractérisés d’indiscipline » (Cass. soc., 17 oct. 1989, n° 86-43.272).
Enfin, le droit de retrait ne saurait donner naissance à une nouvelle situation de risque grave ou imminent, comme une rupture du principe de continuité des services publics. Ainsi, même si un décret du 16 juin 2000 a étendu ce droit à la fonction publique, il s’avère incompatible dans bien des hypothèses. Tel est le cas du milieu pénitentiaire, celui des personnels soignants ou encore de la police, la liste n’étant qu’énonciative. De même, il semblerait particulièrement hasardeux d’exposer un droit de retrait à l’employeur respectueux des directives sanitaires destinées à endiguer le Covid-19 telles que la mise en place du télétravail ou la fourniture des dispositifs déjà énumérés. La validité du retrait d’un travailleur serait évidemment toute autre dans l’hypothèse d’une violation volontaire de ces mesures. N’étant contrôlé par le juge qu’a posteriori, une fois l’exercice intervenu, et étant apprécié au cas par cas, il ne doit pas être occulté qu’il n’y a parfois qu’un pas non négligeable entre le droit de retrait et le retrait de son droit.
Article rédigé par Warren Azoulay, Enseignant Chercheur, FDSP, Aix-Marseille Université.
[1] Sénat, Rapport n° 69 de M. Jacques MOSSION, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 27 octobre 1982, page 39, v. https://www.senat.fr/rap/1982-1983/i1982_1983_0069.pdf
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id